Philippe Bihouix est ingénieur de formation et auteur de L’âge des low tech. Il s’intéresse notamment à la question des ressources non renouvelables et des mutations technologiques de nos sociétés industrielles. Et si nos prouesses technologiques et les énergies « vertes » nous condamnaient aussi sûrement que le gaz et le pétrole ?

Commençons par le commencement. Les low tech, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un mot un peu bizarre. Un anglicisme affreux construit par opposition aux high-tech. En français, on pourrait parler de technologies appropriées, douces, sobres, résilientes…
Aujourd’hui, face aux désordres environnementaux et aux risques sur la disponibilité future des énergies fossiles, on nous présente toute une série de promesses technologiques. Grâce à des millions de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, les technologies, actuelles ou futures, vont tout arranger. Les énergies « vertes », les voitures électriques et/ou autonomes, les smart cities… Ce sera formidable. Grâce aux high-tech et au numérique, la mobilité, l’habitat, les modes de consommation seront complètement transformés, et leur impact environnemental considérablement réduit.
Pourtant, nous faisons face à un problème de ressources. De ressources non renouvelables — qui ne se reconstituent pas à l’échelle d’une vie humaine — et que l’on pioche dans la croûte terrestre, comme les métaux. Les high-tech font appel à des ressources métalliques de plus en plus importantes, plus rares, de plus en plus difficiles à extraire, qu’il faut aller récupérer dans des mines toujours plus profondes — quand on ne lorgne pas sur le fond des océans ou les astéroïdes. Le risque de pénurie n’est pas immédiat, mais les conséquences environnementales et la consommation énergétique associée sont énormes.

Ces matériaux nous éloignent également de l’économie circulaire dont nous rêvons tant. Théoriquement, ces métaux sont bien recyclables. Mais dans la high-tech ils sont utilisés en quantité très faible, souvent mélangés à d’autres matériaux et dispersés, dans des objets à la technologie de plus en plus complexe : tout cela empêche un recyclage efficace.
Les high-tech et leurs promesses ne vont pas résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Bien au contraire, nous les accélérons et nous les aggravons.
J’ignore combien de temps cela peut encore durer, mais nous piochons sans vergogne dans un stock qui a une quantité finie. Avec les high-tech, avec la tentative insuffisamment réfléchie de transition énergétique, le déploiement exponentiel du numérique dans tous les domaines, nous empilons à un extractivisme pétrolier et gazier, un extractivisme minier et métallique sans précédent. Cela ne pourra pas durer des siècles.
De ce constat vient l’idée des low tech. Il s’agit d’un jeu de mots un peu potache pour alerter sur une innovation technologique qui risque de nous amener encore plus vite au bord du précipice. Nous ne parlons pas ici d’un retour à la bougie ou à l’âge des cavernes. Mais d’orienter l’innovation vers un autre chemin, moins consommateur de ressources. Une démarche qui consiste à essayer de mettre la question des ressources non renouvelables davantage au centre des préoccupations.
Vous avez des exemples de low tech ?
J’aime bien résumer la démarche des low tech en trois questionnements : le Pourquoi, le Quoi, et le Comment. Le premier concerne la sobriété. Le produit, le service le moins impactant est celui dont je n’ai pas besoin. Le deuxième s’axe autour de la conception : comment aller encore plus loin dans les démarches d’écoconception ? Le dernier interroge les modes de production. Notamment la place de la machine et la place du travail humain. Depuis plus de deux siècles, nous sommes dans une logique où l’on déploie des machines pour remplacer le travail humain. Cela continue aujourd’hui, avec une nouvelle vague de robotisation, les services numériques, l’intelligence artificielle… Remplacer un humain par une machine ou un logiciel, c’est consommer plus d’énergie et de ressources.
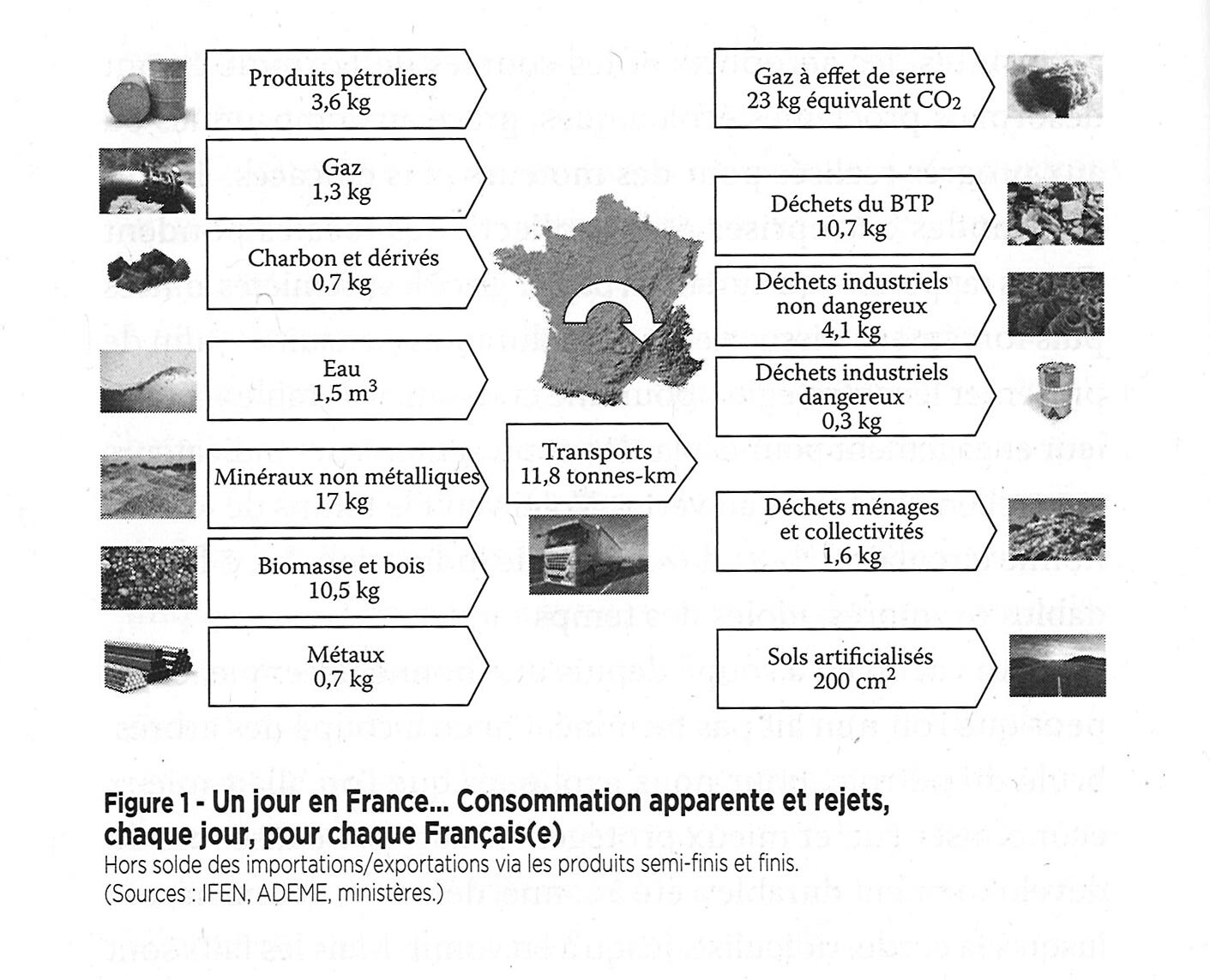
Je suppose que mon smartphone n’est pas très low tech ?
Je pense qu’aucun fabricant de smartphones ne souhaiterait qualifier ses produits de low tech ! Dans votre téléphone, il y a une quarantaine de métaux différents. Lorsqu’il arrive en fin de vie, il ne faut pas le jeter dans n’importe quelle poubelle. Avec un peu de chance, s’il est correctement collecté et trié, il atteindra une des rares usines mondiales qui sait traiter ce genre de déchet extrêmement complexe. Alors, sur la quarantaine de métaux qu’il contient, dont certains dangereux pour l’environnement, on va réussir à en recycler une quinzaine.
Pour la majorité des déchets électroniques, c’est pire : décharge, incinérateur, circuits de recyclage « informel » en Afrique de l’Ouest, au Pakistan ou en Chine… Le smartphone est un exemple emblématique, un objet au rythme de remplacement accéléré, consommateur de ressources précieuses qui seront perdues de façon inéluctable à sa fin de vie.
Que pourrait-on faire dans une démarche low tech ? Déjà, essayer d’améliorer l’écoconception, travailler sur la durée de vie, la réparabilité, la modularité, le réemploi, l’utilisation parcimonieuse des ressources les plus rares… Concevoir des logiciels qui consomment moins de ressources de calcul, de mémoire.
Ensuite, se poser la question de la sobriété des usages. Regardez la liste des équipements de base dans un smartphone : un GPS et un appareil photo, certes, mais aussi un accéléromètre, un gyroscope à trois axes, une station météo complète… A-t-on vraiment besoin de tout ça ?
Le numérique consomme déjà plus de 10 % de l’électricité mondiale. C’est insoutenable et cela va le devenir encore plus.
Il s’agit d’un exemple parmi d’autres. On peut l’adapter à d’autres domaines comme le bâtiment ou la médecine. Des choses assez simples, alliées à des connaissances avancées, peuvent avoir des résultats assez incroyables. Par exemple, des équipes de recherche travaillent sur le diagnostic médical par des chiens. Dans certains types de cancers, on doit exsuder une odeur particulière, et des chiens dressés pour ça, à la façon des chiens douaniers, les diagnostiquent avec un taux de réussite de 100 %.
Aujourd’hui ce sont des IRM, des tests chimiques, une machinerie incroyable… qu’on peut remplacer par un chien. Ce n’est pas le retour à la bougie, bien au contraire. C’est une manière ultra agile, incroyablement intelligente, bien plus résiliente, de prendre un sujet et de le traiter différemment.
Il ne faut pas réduire les low tech à une question de la conception des objets.
Souvent les exemples sont systémiques, comme pour le numérique. Il consomme déjà plus de 10 % de l’électricité mondiale. Il commence à devenir un peu embêtant d’un point de vue environnemental. La quantité de données échangées, stockées et calculées explose. Et nous ne sommes qu’au début de l’aventure, on nous promet encore plus avec le big data, les voitures autonomes, les objets connectés, l’intelligence artificielle… C’est insoutenable et cela va le devenir encore plus.
Pour faire simple, si l’on repensait et retravaillait vraiment sur l’ensemble du système numérique, pour identifier les usages réellement nécessaires et la manière de les fournir, nous pourrions réduire de 95 %, au bas mot, son impact environnemental global. Pour cela bien sûr, il faut accepter un certain nombre de choses.
Par exemple, a-t-on vraiment besoin de mobilité, très énergivore, tout le temps et partout ? A-t-on besoin d’avoir du temps réel systématique, qui génère beaucoup de trafic ? Ne peut-on pas réduire le niveau de performance et de fiabilité attendu, avec des équipements doublés, triplés pour éviter la panne ? Énormément de questions gravitent autour de cela.

Que voyez-vous comme solutions pour l’avenir ?
Je dirais qu’il y a quatre niveaux d’action. Le niveau personnel pour commencer. Certains renoncent à la voiture pour enfourcher un vélo. D’autres vont faire du compost, se lancer dans une démarche zéro déchet, moins chauffer en hiver et renfiler un pull-over… Il y a toute une série de choses à faire au niveau personnel, mais cela atteint vite ses limites, car on vit dans une économie « poussée ». Les consommateurs ont le choix entre un certain nombre de produits seulement. Acheter des gâteaux sans huile de palme pour sauver les orangs-outans, tout en faisant du zéro déchet et du circuit court, le tout à vélo, ce n’est pas toujours si simple. Les courses tournent au sport de combat et cela requiert du temps.
Le deuxième niveau est associatif et local, avec des gens qui se réunissent pour agir. Il y a une foultitude d’énergies, de réflexions, d’envies, d’idées, d’expérimentations… Ils vont ouvrir des recycleries, des repair cafés, créer des AMAP… Mais cela atteint aussi ses limites si le troisième niveau, celui de l’État, n’intervient pas pour soutenir ces initiatives et provoquer un basculement plus généralisé.
Son pouvoir de prescription peut être énorme. Il peut mettre en place des critères environnementaux plus forts dans les achats publics. Rendre le recyclage, le travail humain, plus avantageux économiquement par le biais réglementaire et les orientations fiscales. Pourquoi ne pas réduire les charges sur le travail et faire porter le coût de la protection sociale sur l’énergie et les ressources, par exemple ? Sans oublier les mécanismes de soutien à l’innovation. Est-ce durable, résilient, de mettre des centaines de millions d’euros pour faire de la France un champion de l’intelligence artificielle, de la voiture autonome, du numérique… ? Si à chaque euro mis dans le numérique, on en mettait un autre sur l’innovation locale, territoriale, créatrice d’emploi dans l’économie sociale et solidaire, le résultat serait à mon avis incroyable.

Et puis le quatrième niveau, le niveau multilatéral avec les COP ou l’Europe, où la diplomatie cherche à faire avancer les choses. Ce niveau est indispensable, mais le passé a montré qu’il est extrêmement difficile de se mettre tous d’accord sur une évolution plus drastique vers une économie soutenable. Les histoires, les contraintes locales, les intérêts sont trop divergents. Il faut malgré tout continuer à dialoguer, mais il ne faut pas trop en espérer et essayer d’avancer de notre côté.
Philippe Bihouix sera en conférence à Bordeaux à l’occasion de Climax Session ce lundi 23 avril.
Photo de couverture : Flickr