À l’occasion de la table ronde « Tout le plaisir est pour moi » organisée par Revue Far Ouest ce 5 juillet à l’I.BOAT, nous avons eu envie d’élargir nos perspectives. Nous nous sommes interrogés sur l’éducation féministe telle que perçue par les jeunes aujourd’hui et leurs vecteurs de sensibilisation. Les sociologues Magali Della Sudda et Viviane Albenga, la géographe Édith Maruéjouls et la rédactrice des Petites Glo Florence Fortuné nous parlent de l’école, d’internet… et de l’éducation des garçons.
Soirée « Tout le plaisir est pour moi »
Le 5 juillet à l’I.BOAT
ENTRÉE LIBRE
« Féminisme et égalitaire, c’est juste synonyme », pose Florence Fortuné, rédactrice-en-chef de la newsletter féministe pour adolescent·e·s Les Petites Glo. « Donner une éducation féministe, c’est juste rattraper des siècles et des siècles d’inégalités. » Dans sa démarche d’empowerment des jeunes filles et d’inculcation de valeurs égalitaires aux garçons, l’éducation féministe doit se faire tôt.
Intérioriser le féminisme
« Même si d’énormes progrès ont été faits depuis 30 ans, il y a eu des reculs », constate la sociologue Magali Della Sudda. « L’éducation que les enfants avaient dans les années 70-80 est beaucoup moins répandue aujourd’hui. En tout cas, au début des années 2000 où on voyait des comportements sexués plus marqués. » La spécialiste du genre au centre de recherche bordelais Émile Durkheim pointe un contexte social paradoxal : « Il y a des normes égalitaires de plus en plus mises en œuvre dans les lois, et en même temps une culture liée à notre société de consommation dans laquelle pour vendre plus, il faut segmenter les marchés : on a tout intérêt à exacerber la différence entre les hommes et les femmes. »
Elle relève deux difficultés pour mettre en place une réelle éducation féministe : « On actualise tous les jours un certain nombre de choses qui sont associées à notre identité genrée. » Parmi ces stéréotypes, une fille ne joue pas au foot. Elle accuse aussi un environnement qui « vient parfois heurter brutalement les modèles un peu émancipateurs ou égalitaires proposés aux enfants. » S’il le veut, un garçon peut mettre une jupe, mais il devra résister aux regards critiques que ses pairs porteront sur lui.
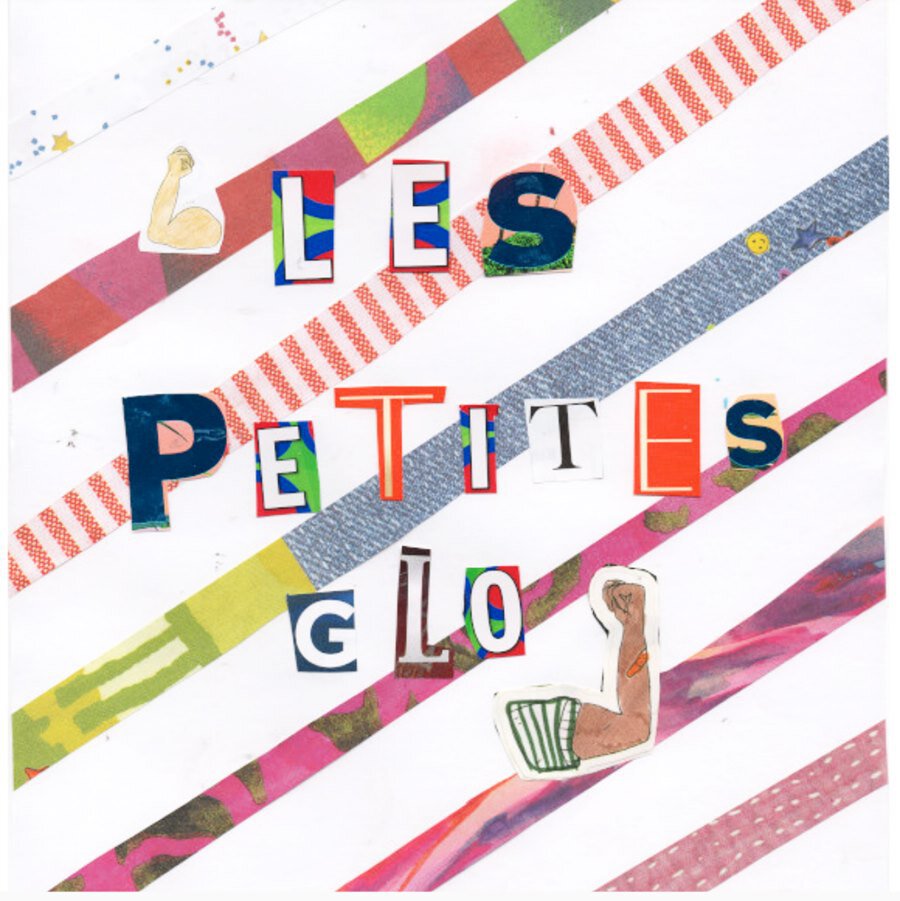
Il y a quelques années, les gens pensaient encore « qu’il n’y avait plus besoin du féminisme, parce que “c’est bon, maintenant, les femmes ont le droit de voter” », désespère Florence Fortuné. « Beaucoup voyaient encore le féminisme comme un combat d’ “hystériques”. » Mais la rédactrice-en-chef des Petites Glo nuance avec ce qu’elle perçoit : « Aujourd’hui, il y a énormément d’ados pour qui le féminisme apparaît comme une évidence. À 12-13 ans, elles savent déjà ce que c’est et ont des icônes ultra-inspirantes, comme Beyoncé ou Malala. C’est plus ou moins mis en avant dans les médias, pas toujours de la bonne manière, mais au moins on en parle. » Cette intériorisation des valeurs féministes s’accroît du fait que les adolescent·e·s grandissent avec les réseaux sociaux et les mouvements tels que #metoo ou #balancetonporc.
L’éducation par voie numérique
« Il ne faut pas nier le pouvoir des hashtags », défend Florence Fortuné. Depuis l’apparition de #Metoo, #Balancetonporc, #Payetaplainte… de plus en plus d’adolescent·e·s évoluent dans une atmosphère où les violences faites aux femmes ne sont plus tolérées. « Les réseaux sociaux sont un moyen d’éducation au féminisme indéniable », poursuit la community manageuse. Selon elle, ces plateformes apparaissent comme « des endroits où les combats féministes ont réussi à se faire entendre. » Les jeunes se sont saisis de la libération de la parole des femmes pour se constituer une conscience féministe.
Les blogueur·se·s et influenceur·se·s remplacent les enseignants dans l’éducation féministe des jeunes, alors que YouTube et Instagram génèrent plus de trafic que Facebook aujourd’hui. @Jemenbatsleclito, @Lesfoliespassageres, @Mercibeaucul… Autant de comptes aux dizaines de milliers d’abonné·e·s destinés à ce que les filles prennent leur sexualité en main. Souvent invisibilisés par Instagram pour contenu pornographique, ils continuent de diffuser des témoignages, images suggestives, et textes prônant le plaisir féminin pour briser le tabou.
Les réseaux sociaux ont parfois été accusés d’accroître les comportements sexistes, les critiques étant fondées sur l’image et touchant plutôt les filles. Sur Instagram, le #summerbody, qui consiste à exposer un corps digne d’une mannequin pour la saison estivale, compte 3,4 millions de publications. Mais son antonyme qui prône l’acceptation de son corps tel qu’il est, le hashtag #bodypositive, rencontre plus de succès, comptabilisant 10 millions de publications. « Les réseaux sociaux font circuler des concepts féministes », remarque Viviane Albenga. Le groupe Facebook Le Salon des Dames poste des articles informatifs sur la condition féminine à travers le monde et prône la pilosité féminine. La dessinatrice Emma a quant à elle rendu populaire le concept de « charge mentale ».
Ces lieux de discussion sont aussi des espaces d’organisation : les Campusciennes, groupe non mixte de l’Université Bordeaux-Montaigne, élève le débat quant au harcèlement sexuel sur le campus et tient des réunions d’information organisées sur Facebook. Suite à cette prise de conscience, la chercheuse Viviane Albenga a relevé un changement de comportement pour les femmes : « Elles ont décidé de ne plus se laisser faire si elles sont harcelées dans la rue. »
Les réseaux sociaux sont le principal vecteur d’éducation féministe, pour Florence Fortuné. À l’opposé, la spécialiste de la géographie du genre Édith Maruéjouls considère qu’une grande partie de cette éducation doit être réalisée à l’école.
Apprendre le féminisme à l’école ?
« À l’école, les garçons prennent toute la place et les femmes sont déjà mises sur le côté, » s’insurge Florence Fortuné. Dans l’espace pédagogique où les enfants doivent apprendre qu’ils sont égaux, l’environnement est déjà marqué de la domination masculine. Ce à quoi Édith Maruéjouls essaie de remédier. La docteure en géographie a créé l’Atelier Recherche OBservatoire Égalité (L’ARObE), basé à Bordeaux, en 2014. Avec les collectivités, elle travaille sur l’égalité femmes-hommes dans l’espace public et intervient auprès de classes d’âges différents pour inculquer une conscience féministe aux jeunes et en finir avec les inégalités.
La tenue vestimentaire, « première charge mentale » selon la directrice, est régie par les injonctions sociétales. Vêtements élégants, mais pas trop courts ; pas de short puisque les règlements intérieurs stipulent que les jambes des filles sont plus indécentes que celles des garçons. Pendant qu’elle leur offre ces espaces de parole, Édith Maruéjouls questionne les représentations. « Il y en a qui provoquent » revient souvent de la part des garçons. Alors Édith Maruéjouls met en place un dialogue : que provoquent-elles ? Qu’est-ce qu’un viol ? La tenue vestimentaire rend-elle légitime cet acte ?
« À l’école, on ne vous montre jamais des femmes fortes comme Malala », regrette la rédactrice des Petites Glo Florence Fortuné. Oui, les femmes peuvent occuper des postes à haute responsabilité. Encore faut-il qu’elles y croient, « qu’elles aient des modèles tout aussi ambitieux et valorisants que ceux proposés aux petits garçons », souligne la sociologue du genre Magali Della Sudda. Certaines initiatives ont alors été prises.
Social Builder procure des cours de codage pour les femmes seulement, car « le numérique a besoin des femmes et les femmes ont besoin d’être présentes dans des métiers d’avenir », justifie la déléguée générale du projet, Emmanuelle Laroque. Ces avancées pédagogiques émanent parfois de l’État : une circulaire en 2013 promouvait les enseignements sur le genre et l’égalité filles-garçons à l’école. « Des choses ont été mises en œuvre et portent leurs fruits. Ce qui n’empêche pas pour autant des normes inégalitaires. »
Et dans l’inégalité, toutes pointent les cours d’éducation à la sexualité, sans lesquels l’éducation féministe ne peut se faire. « Il y a énormément d’adolescent·e·s qui ne se masturbent pas parce que c’est sale », a constaté Florence Fortuné. De même que la Bordelaise Viviane Albenga regrette une éducation sexuelle « envisagée comme la prévention des risques », le plaisir féminin ne trouvant pas sa place parmi les thèmes « capote » et « MST ». « On pense les choses de manière trop médicalisée, et non en termes de relation filles-garçons, » ce que regrette la sociologue. « Cela responsabiliserait les garçons dans leur part du travail relationnel et les formerait à davantage d’empathie. » L’éducation féministe ne concernerait plus seulement les personnes dotées d’un clitoris.
L’éducation féministe, une histoire de femmes ?
La sociologue Viviane Albenga aimerait que les stéréotypes se déconstruisent, mais l’éducation féministe a été « pensée pour les filles ». Magali Della Sudda questionne alors les figures masculines : « Une éducation féministe pour les petits garçons peut consister à proposer des modèles de masculinité, de devenir qui n’est pas nécessairement des modèles de compétition, où l’on doit dominer les autres. »
Édith Maruéjouls « provoque la mixité ». Avec le centre d’études L’ARObE, elle met en place un aménagement de l’espace public égalitaire. Pour elle, la sororité, ou non-mixité entre femmes, n’apparaît pas comme une solution pour la prise de conscience féministe des hommes en devenir. Viviane Albenga, qui réalise une étude auprès d’étudiantes bordelaises, a remarqué qu’elles souhaitaient une écoute de la gent masculine, mais peu d’hommes se montrent volontaires.
« Des hommes ont pris conscience de l’ampleur des violences, mais je pense qu’on est dans un contexte où certains hommes pensent qu’ils ne peuvent plus rien dire parce que c’est du politiquement correct et qu’il ne faut pas avoir l’air de faire une blague, car ce serait du harcèlement. Certains ont changé leur comportement, pas parce qu’ils ont pris conscience, mais parce qu’ils ont peur. » Elle émet toutefois quelques réserves puisque son étude sur la perception de #metoo par les hommes ne sera réalisée qu’à la rentrée.
En 2019, on observe un environnement numérique et médiatique qui valorise le féminisme. Viviane Albenga le relève : « Institutionnellement, ça ne progresse pas beaucoup, ce serait même plutôt l’inverse. Par contre, dans la société civile, je pense qu’il y a une accélération. Et surtout du côté des femmes. » Prochain défi : intégrer les hommes dans le processus.
Photo de couverture : GREG KANTRA sur Unsplash