Déjà difficile en temps normal, la situation des enfants placés durant le confinement devient intenable.
Photo de couverture : Annie Spratt
Nous avons besoin de 1 000 nouvelles souscriptions pour continuer à exister.
Découvrir nos offres d’abonnement« On sacrifie des gosses. » La voix est lasse, usée. Mais Lyes Louffok, qui incarne depuis plusieurs années la lutte en faveur des droits des enfants placés en France, reste combatif. Il se dit « catastrophé » par la situation actuelle et par les conséquences du confinement.
« Les dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne sont pas nés avec la crise sanitaire. Celle-ci ne fait que les mettre en lumière, mais elle les accentue aussi douloureusement », estime cet ancien enfant placé, auteur de Dans l’enfer des foyers, paru chez Flammarion. L’ASE est ce dispositif qui intervient dès lors qu’il y a des violences à l’intérieur des familles, mais aussi quand l’autorité des parents est défaillante.
Si la situation le permet, il peut être décidé de laisser l’enfant dans sa famille, mais en le faisant suivre par un éducateur. L’ASE a aussi le pouvoir de saisir le juge des enfants ; lequel décide, dans certains cas, de confier l’enfant à des proches, à une famille d’accueil ou à un « lieu de vie », communément appelé « foyer ».
Il y en a qui ont été renvoyés dans leurs familles alors même que le processus de retour n’était absolument pas terminé
Tout au long du processus, chaque enfant est accompagné par un éducateur de l’ASE qui est son « fil rouge », et coordonne les actions des uns et des autres. L’ASE prend en charge les placements judiciaires décidés par le juge des enfants : ils représentent 80 % des cas. Mais elle traite aussi des placements administratifs, ceux qui se font avec l’accord du ou des détenteurs de l’autorité parentale — qui peuvent y mettre fin à tout moment.
Les départements souverains
Depuis 1983 et la décentralisation, l’ASE relève de la responsabilité des départements. Ceux-ci lui ont consacré 8,3 milliards d’euros en 2018, mais avec des disparités énormes, car ils ont la liberté de lui attribuer le financement qu’ils souhaitent. En 2017, le Rhône n’y dédiait que 5 % de son budget, contre 19 % en Charente-Maritime. « Il y a 101 départements, et autant de politiques différentes », résume Lyes Louffok.
Or cette institution est, y compris en temps normal, défaillante : 70 % des jeunes suivis n’obtiennent pas de diplôme ; les filles ont 13 fois plus de risques que la moyenne de tomber enceinte avant leur majorité ; un SDF sur quatre est un ancien enfant placé. Et ce, alors même qu’ils ne représentent que 2 % des mineurs — 341 000 en 2017.
Au-delà des chiffres, profondément révélateurs, des drames viennent régulièrement pointer les failles de l’ASE : le meurtre de la petite Vanille, à Angers, en février ou celui d’un mineur par un autre à Suresnes, quelques semaines plus tôt, l’ont douloureusement rappelé…

C’est donc dans ce contexte que le confinement a été décrété, mi-mars. Avec des conséquences potentiellement dramatiques pour les enfants placés. « Il y en a qui ont été renvoyés dans leurs familles alors même que le processus de retour n’était absolument pas terminé », accuse Éric, éducateur spécialisé dans un foyer d’un département de Nouvelle-Aquitaine.
Dans certains cas, en effet, les enfants reviennent progressivement chez leurs parents : quelques heures, puis un week-end, puis davantage de temps si les choses se passent bien, avant d’envisager d’y vivre à nouveau en permanence. Un processus long de plusieurs mois, qui peut être interrompu au moindre doute des services sociaux. « Lorsque les enfants rentrent après ces séjours dans leurs familles, on s’aperçoit généralement très rapidement d’un éventuel problème. Là, on les appelle pour savoir comment ils vont, mais on ignore s’ils peuvent tout nous dire, s’ils ne sont pas surveillés ou menacés par leurs parents », poursuit Éric.
« On les abandonne à ceux qui ont été leurs bourreaux », corrobore Lyes Louffok. « Et ce, en dehors de toute procédure légale, puisque seul le juge des enfants est habilité à renvoyer l’enfant dans sa famille dans le cadre d’un placement judiciaire. »
La justice à l’arrêt
Car avec le confinement, ce sont aussi toutes les procédures judiciaires qui ont été gelées. Celles qui concernent les enfants en foyers, mais aussi celles qui pouvaient conduire à un placement. Des situations dans lesquelles des mineurs avaient fait l’objet d’un signalement ou de suspicions, et dont les dossiers étaient en cours d’examen ou d’instruction.
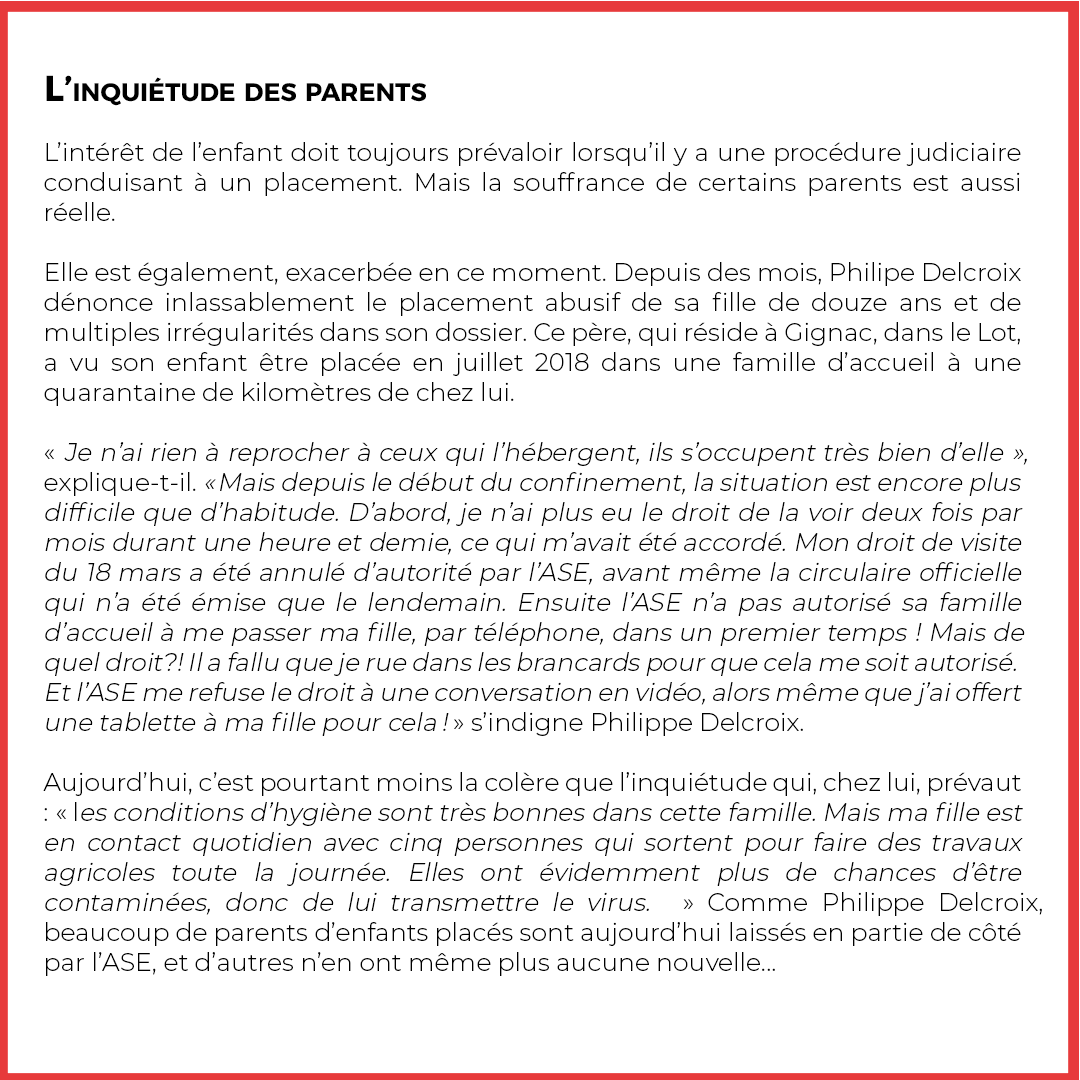
« Je fais partie des professionnels qui interviennent pour évaluer le cadre familial, les capacités éducatives des parents, les éléments de personnalité, etc.. », commence Nikki, psychologue dans un service de protection de l’enfance d’un département limitrophe de la Nouvelle-Aquitaine, région où elle réside.
« Parmi les enfants que nous suivions, il y en a un pour lequel nous allions recommander un placement. Là, tout est arrêté et nous sommes très inquiets pour ce petit, qui nous parait être en danger. La police interviendra s’il y a des violences physiques, mais encore faut-il les détecter, surtout dans cette période. Et on sait très bien que les mauvais traitements peuvent aussi être d’autres natures », rappelle Nikki.
Pour ces enfants, laissés ou renvoyés chez eux, la situation est donc terrible ; pour ceux qui sont restés en foyers, elle n’est guère plus enviable. « Nous accueillons des mineurs à partir de 6 ans, et de tous jeunes majeurs de 18 ans », résume Yasmine Achour, qui travaille dans une maison d’enfants à caractère sociale (MECS) de Toulouse. « Nous avons réussi à confier certains des plus petits à des familles d’accueil, mais nous restons avec une quarantaine d’enfants, contre une soixantaine habituellement. Ce sont des jeunes déjà très angoissés, aux parcours de vie compliqués, qui ont du mal, parfois, à prendre conscience de la situation. Et qui se retrouvent entre eux à temps plein, n’ayant même plus l’école pour couper. Les tensions sont exacerbées. »
Les travailleurs sociaux sont des soignants !
« La barrière entre haussement de ton et violence physique est de plus en plus mince », complète Pauline, assistance sociale dans une MECS qui accueille une trentaine de mineurs isolés en Nouvelle-Aquitaine. « Nous sommes en sureffectif par rapport à nos capacités d’accueil, et nous sommes moins d’encadrants que d’habitude. On part la boule au ventre. Les jeunes vont exploser. »
« Les personnels ne comptent plus leurs heures, d’autant que tous ne peuvent venir travailler, puisque certains ont une santé fragile. Émotionnellement, c’est difficile. Nous avons le sentiment d’être abandonnés ; nous avons dû fabriquer nous-mêmes des masques, par exemple, avant d’en recevoir quelques-uns en fin de semaine dernière », reprend Yasmine Achour.
« Les travailleurs sociaux sont des soignants ! » tempête Lyes Louffok. « Ils ne soignent pas des blessures visibles, certes, mais ils devraient être protégés. Or personne ne l’est. »
Appel aux dons
« On demande à l’Agence régionale de santé (ARS), à la préfecture, mais elles se défaussent sur le département, lequel ne bouge pas, ne nous donnant rien pour nous protéger », constate Myriam Subra. Elle est la responsable des achats de l’association arcachonnaise « Au Moulleau avec Vincent de Paul » qui héberge 71 mineurs d’ordinaire. Au début du confinement, 26 d’entre eux ont été renvoyés dans leur famille. Tous sur décision du juge des enfants, donc en conformité avec la loi.
Que valent nos vies, celles des enfants placés ? Pour les pouvoirs publics, on doit faire partie de ces gens dont la mort est, somme toute, acceptable…
« Pour les 45 qui restent, c’est très compliqué d’appliquer les mesures d’hygiène. D’abord parce qu’il y en a, parmi les plus âgés, qui vivent en appartement et peuvent donc être en contact avec l’extérieur. Ensuite nous rentrons chez nous, nous allons faire les courses, nous pouvons aussi être porteurs du virus. Et nous n’avons rien pour nous protéger, sauf quelques masques que nous avons nous-mêmes achetés et que nous utilisons avec beaucoup de parcimonie. De plus, ces enfants sont fragiles, psychologiquement. Certains ne voient plus du tout leur fratrie, leurs parents, et sont très en demande. Mais nous manquons de matériel informatique pour organiser des vidéoconférences. Nous manquons de tout, en fait. Même pour les thermomètres, nous sommes sur liste d’attente. » L’association vient d’ailleurs de lancer un appel aux dons, et une cagnotte Leetchi pour parer au plus pressé.
Ces situations sont loin d’être isolées. Partout ou presque, les professionnels font état d’une pénurie de moyens particulièrement criante et de mesures de distanciation sociale difficiles, voire impossibles à appliquer. Avec des conséquences parfois dramatiques : « ici, nous avons 7 jeunes et 2 adultes dans 100 m2 », reprend Éric. « Sans masques, sans gants, sans rien. Il y a quelques jours, un enfant est tombé malade, très probablement du coronavirus ; il en avait tous les symptômes. Il n’a même pas été testé ! Et l’un de nos collègues l’a attrapé à son tour. Nous sommes démunis et personne ne se préoccupe de notre sort ni de celui des enfants. Ils sont encore la cinquième roue du carrosse, comme toujours », déplore l’éducateur spécialisé.
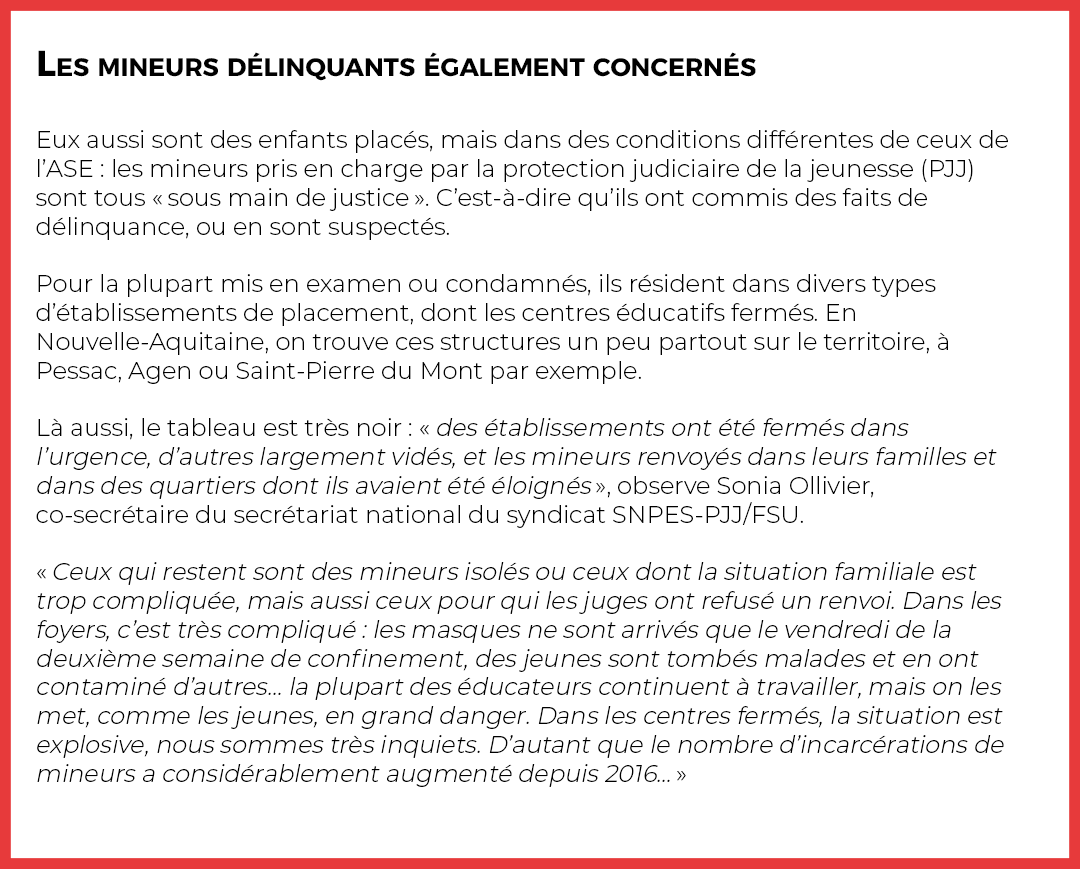
« C’est peut-être ça, le plus dur », confirme Yasmine Achour. « Déjà que d’habitude ces enfants ont le sentiment d’être oubliés, là ils se sentent totalement abandonnés de tous, ou presque. C’est très violent. »
« On tente de garder le sourire, pour les enfants », relate Myriam Subra. « Quand on les voit jouer et rire, cela redonne du sens à ce qu’on fait. Mais on voit bien qu’ils ont conscience d’être encore un peu plus laissés pour compte. »
« Le système est en train d’exploser », résume Lyes Louffok. « Je pense aux petits handicapés, qui représentent 30 % des enfants placés et pour qui il y a rupture de soins. Je pense aux foyers où des jeunes vont voir la violence à leur encontre s’amplifier encore. À ces mineurs abandonnés à leur sort dans des hôtels… Et je pense à ces enfants qui sont dans leurs familles, à la merci de leurs bourreaux. Si l’un d’eux meurt, je porterai plainte contre l’État pour défaut de protection. Mais que valent leurs vies ? Que valent nos vies, celles des enfants placés ? Pour les pouvoirs publics, on doit faire partie de ces gens dont la mort est, somme toute, acceptable… »