Les différentes phases de confinement et de couvre-feu imposées par l’État français afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 ont leurs oubliés. En premier lieu, les sans-abris et les précaires qui font face à une superposition de complications, qu’elles soient administratives, médicales, sociales ou psychologiques.
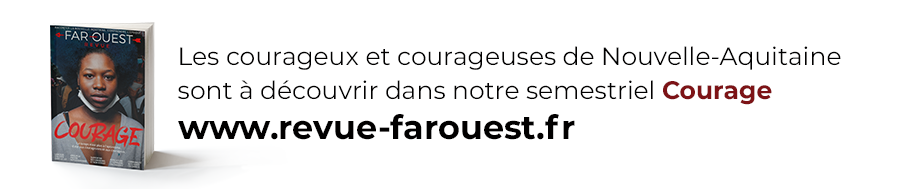
Le 10 février 2020, Anne-Marie trouvait refuge entre deux étages d’un parking souterrain, près du pont Chaban-Delmas. Cette femme de 66 ans, rien ne la distingue vraiment des autres, au premier abord. Elle pourrait être cette mère ou cette grand-mère qui nous est proche, où simplement une anonyme croisée au détour d’une rue sur les pavés bordelais.

« Mauvaise éducation »
Elle, qui s’est « construite et déconstruite » en région parisienne, se qualifie malicieusement de « mauvaise éducation versaillaise » ; un contexte familial où sa mère se consacrait exclusivement à l’éducation des enfants, pendant que le père subvenait aux besoins de la famille. Adulte, Anne-Marie, avorte quelques cursus et en réussit d’autres. Titulaire d’un Master en Histoire-Géographie et d’une licence en Littérature — mais peu intéressée par l’enseignement —, elle passe un diplôme de Contrôleuse de gestion. C’est dans son studio à Chaville (92) qu’elle entame une vie professionnelle hachée : son quotidien, c’est l’intérim et l’instabilité. Elle se remémore sa première mission : c’était en 1981, l’année du retour de la gauche au pouvoir. Elle intégrait une entreprise de fabrication de climatiseurs automobiles pour la filiale Renault.


Une mission qui allait en appeler d’autres. Mais elle le sait : ce mode de vie ne lui permettra pas de faire face à d’éventuels accidents de parcours. En 2002, son père, qui gère plusieurs salons de coiffure, décède des suites d’un cancer. La vie d’Anne-Marie bascule alors : l’homme était criblé de dettes. La pension de réversion qui est versée à la famille sert intégralement à les éponger, et le minimum vieillesse accordé à sa mère est bien insuffisant. Les souvenirs de Chaville sont placés dans un garde-meuble, et les deux femmes décident de quitter la région parisienne.
Direction le Sud-Ouest de la France. Après quelques semaines à l’hôtel, elles s’installent en octobre 2016 dans le Blayais, à Saint-Seurin-de-Cursac. C’est le temps du chômage, puis du Revenu de Solidarité Active (RSA). Un an plus tard, la politique de solidarité en France se raidit et les contrôles d’attribution des allocations se voient drastiquement durcis. Anne-Marie et sa mère — l’une au RSA, l’autre au Minimum vieillesse — vivaient ensemble sans l’avoir déclaré. Elles sont sanctionnées. Leurs sources de revenus fondent comme neige au soleil, et les mois qui suivent se résument à une succession de dettes. En avril 2019, elles quittent leur logement, et leurs chemins se séparent : pendant que sa mère s’oriente vers l’hôpital Saint-André — elle obtiendra plus tard un logement en EHPAD — Anne-Marie passe l’été dans un parking, installée sur un lit de camp, entre un ascenseur un mur. Pour ne pas gêner la clientèle, elle décide de n’accéder à cet abri de fortune que tard dans la nuit et de quitter le lieu aux aurores. Depuis le mois d’octobre, son refuge lui est inaccessible. Alors, la nuit venue, elle arpente les couloirs de la gare Saint-Jean jusqu’à la fermeture des portes, avant d’errer dans les rues bordelaises jusqu’au petit matin.
Dehors, l’errance.
Après avoir passé plusieurs journées en Centre d’hébergement d’urgence, elle contacte le Samu Social et rencontre des administrations. Plus que jamais, elle se sent déshumanisée, réduite à un vulgaire dossier, transmis de main en main. Sa crispation est totale, d’autant que le garde-meuble familial de Chaville s’est converti en un objet de blocage : les dépenses liées à la location de ce dernier l’empêchent d’obtenir un logement.
Alors que le silence fond sur la ville aux premières heures du confinement, ces questionnements — et d’autres — tournent en boucle dans sa tête. Nous sommes le 17 mars 2020. Pour Anne-Marie, les journées se ressemblent toutes. Entre la visite de lieux d’accueil « afin de trouver un peu de réconfort » et les allers-retours en tram, de terminus en terminus, pour tuer le temps. Une solution pour dormir au chaud quelques heures. Un soir, alors qu’elle se trouve devant un restaurant, une femme lui apporte à manger : « Une petite dame comme vous, ça ne peut pas être dans la rue », lui assène cette inconnue, pleine de bienveillance. Anne-Marie n’est pas au bout ses surprises : cette personne l’hébergera pendant quelque temps. D’autres anonymes lui viendront également en aide, en la logeant pendant quelques jours. Anne-Marie insiste : la première nuit, elle dort systématiquement très mal, comme si elle ressentait encore la tension du dehors, celle qui la tenaille quand elle traverse une rue. Et, dès qu’elle s’allonge, le moindre bruit la fait sursauter.


L’arrivée du froid a engourdi une de ses jambes. Souvent, elle s’abrite dans des églises, qui sont pour elle un « refuge de proximité ». Et elle ne cache pas sa colère, face à l’absence totale de moyens mis en place par l’État : aucun gymnase — pourtant fermés à cause des mesures contre le covid-19 — n’a été ouvert pour les sans-abris. Après un long silence, Anne-Marie libère sa parole : « Même si je trouvais un appartement demain, j’aurais un temps d’adaptation avant de parvenir à me reposer vraiment. Il y a comme une chape d’anxiété qui flotte au-dessus de moi. Je sais que je suis agressive parfois. Souvent, sans doute. Mais la rue, le qui-vive permanent. Les moments de relâchement sont si rares. Ils existent tout de même, que cela soit au Wanted café ou dans les murs de l’association Toutes à l’abri. Ces lieux permettent aux personnes comme moi de s’asseoir et de partager un repas avec d’autres, sans se presser, est-ce que l’hiver change quelque chose à ma situation ? Le froid oui, et pire, encore, l’humidité, mais finalement, quelque-soit la saison le sentiment d’humiliation est omniprésent. Surtout depuis que j’ai subi une agression sexuelle dans un centre d’urgence. Je crois que ce qui me ronge le plus, c’est de me dire qu’aujourd’hui c’est comme ça, et que demain, ça sera pareil. », assène-t-elle. La nuit tombe sur la ville.




