La nuit : un chantier constamment en travaux. Les mairies s’en saisissent progressivement et les spécialistes de l’urbanisme aussi. Nos confrères de la Revue Cambo lui ont même consacré leur dernier numéro. Tour d’horizon avec Stella Manning, chargée d’étude à l’agence d’urbanisme A’urba qui a coordonné ce dossier spécial.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire un numéro sur la nuit ?
On essaie d’avoir un coup d’avance dans notre réflexion, d’avoir des dossiers de défrichement. On s’est rendu compte qu’on n’était pas tant précurseurs puisque la ville de Bordeaux travaillait sur cette question de façon parallèle. La prise en compte des questions de nuit dans les politiques locales se fait en sous-marin et n’est pour l’instant pas du tout affichée. Dans la revue Cambo, on a défriché pas mal de thèmes, le sport, les saisons, la périurbanisation, l’économie et le thème de la nuit est venu naturellement parce qu’il émerge depuis une dizaine d’années.
La spécificité bordelaise : l’impact des grands projets urbains sur la question des activités nocturnes.
Pourquoi ce thème a-t-il été tant délaissé ?
Les politiques publiques de la nuit étaient au départ limitées à l’entretien, quelque chose d’administratif, d’assez formaté. Puis est intervenu le champ de la politique sociale et des préventions. À Bordeaux, ça a commencé avec les problèmes de drogue et d’alcoolisation. Il y a eu aussi la série des noyades dans la Garonne aux alentours de 2013. On a commencé alors à se poser plus précisément la question de comment gouverner la nuit.
Cela a d’ailleurs émergé de façon parallèle dans les autres agglomérations : Paris, Nantes, Toulouse, Rennes… Ils se sont rendus compte qu’une métropole vit toute la nuit et qu’il y’a toujours des temps et des lieux de friction entre les activités. Mais en même temps ils savent que l’attractivité d’une métropole est aussi sa vie de nuit, qu’ils ne peuvent pas tout étouffer. Qu’il leur faut donc réguler plutôt que combattre. Et c’est dans cette optique-là que réfléchissent maintenant les grandes métropoles : comment garder leur attractivité tout en limitant les dégâts en termes de comportement et de conflits de voisinage ?
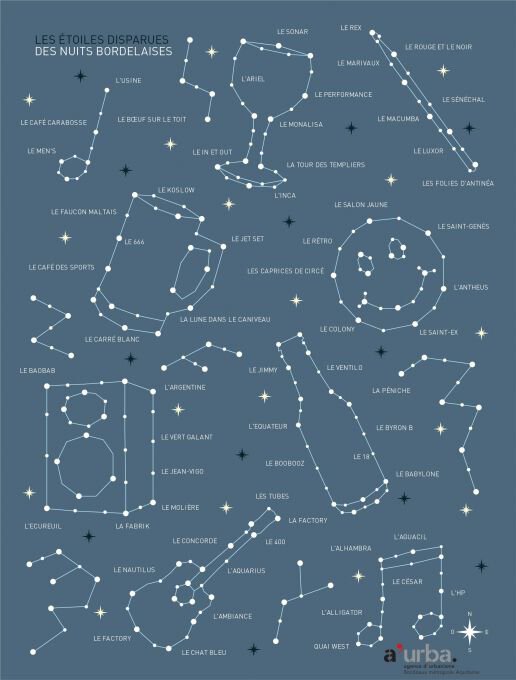
Qu’est-ce qui est spécifique à la nuit bordelaise ?
Ce sont ses grands projets d’urbanisme qui impactent directement des lieux de vie de nuit avec notamment Euratlantique qui construit Quai de Paludate. Il y a des négociations qui sont en cours pour réguler ce quartier (peut-être un peu trop) et aller vers des activités plus qualitatives. Cela pose des questions parce que réguler est une chose, mais ces activités vont de toute façon continuer. Et si ce n’est plus à Paludate, où iront-elles ? On parle aujourd’hui de la ré-émergence du quartier Bassins à Flots comme nouveau lieu de nuit. Pour autant, le quartier Bassins à Flots qui fait partie de cette opération d’urbanisme d’envergure n’a pas du tout été conçu comme possible réceptacle d’activités de nuit. Ce serait donc ça la spécificité bordelaise : l’impact des grands projets urbains sur la question des activités nocturnes.
On parle de la ville-détresse avec la question de la place des femmes et de leurs peurs la nuit.
Pourquoi Bordeaux n’arrive pas à délimiter un quartier attribué à ces activités ?
Mais parce qu’il me semble que ça ne se décrète pas ! La thèse de Cécilia Commelli (qui a coordonné ce numéro de Cambo avec moi) est de montrer comment les aménagements urbains ont pu dans certains cas « booster » une activité nocturne en la gentrifiant, en la polissant, comme dans le quartier Saint-Pierre qui était le coupe-gorge de Bordeaux et qui est maintenant devenu relativement bobo avec une activité nocturne dynamique ; et comment dans certains cas ça peut l’étouffer. Or, on n’étouffe pas l’activité nocturne, elle se déporte de toute façon, quitte à se développer dans l’espace privé, avec des fêtes qui peuvent poser autant voire plus de problèmes à la force publique qui a beaucoup de mal à la réguler.
Au fur et à mesure de la rédaction des articles de ce numéro, quelle pelote avez-vous déroulée, qu’est ce que vous avez découvert ?
On a vraiment essayé d’élargir les angles choisis. On a axé sur la gouvernance, mais aussi sur le travail de nuit, le Samu social, les éboueurs… Et puis on parle de la ville-détresse avec la question de la place des femmes et de leurs peurs la nuit. On y découvre que Bordeaux contient encore beaucoup d’endroits anxiogènes pour les femmes et qu’il y’a plusieurs initiatives mises en place pour pallier à ces inquiétudes.

Il y a aussi une interview de Christophe Vidal, l’ancien « maire de la nuit » à Toulouse. Est-ce que la création de ce poste dans plusieurs grandes villes de France a selon vous apporté des améliorations ?
Les différentes expériences menées dans les agglomérations françaises n’ont pas mené à des modifications pérennes pour le moment. Les villes se cherchent encore sur cette question. Globalement c’est l’émergence d’une prise en compte des problématiques de nuit. Ce qui peut être intéressant c’est que les personnes désignées à ce poste soient vraiment en interface entre le monde de la nuit et le monde public, celui du jour.
Qu’elles ne soient pas juste des porte-parole comme dans certaines villes où l’élection s’est faite dans un bar ou une boîte de nuit et devient de l’ordre du lobby. En tout cas Bordeaux avance à petits pas sur la question. Je sais qu’ils cherchent de manière transversale à fédérer un grand nombre d’élus aussi bien dans le domaine de l’urbanisme que de l’économie ou du tourisme. Il y’a un travail à faire en interne avant d’ouvrir ces questions vers l’extérieur.
Pour plus de détails, le numéro 12 de la Revue Cambo est toujours en kiosque